Lauréats canadiens de 2022 de prestigieux prix internationaux en recherche
Reconnaissance internationale de l’excellence canadienne
La population canadienne a toutes les raisons d’être fière des travaux de recherche menés dans les universités et instituts de recherche du Canada. Qu’il s’agisse de faire la lumière sur la fragmentation des habitats et ses effets sur la conservation des espèces, de mieux comprendre les cellules cancéreuses, de mettre au point des outils émettant les plus courts faisceaux lumineux jamais produits par l’être humain ou de lever le voile sur l’origine des planètes, les chercheuses et chercheurs du Canada aident à trouver des solutions aux plus grandes problématiques et questions du monde. En 2022, 25 scientifiques d’établissements canadiens ont vu leurs travaux reconnus à l’échelle internationale, et ont reçu une variété de récompenses, y compris un prix Wolfe ainsi qu’un prix Frontiers of Knowlege de la Fondation BBVA, de même qu’un grand nombre de Bourses de recherche Guggenheim et de Bourses de recherche Sloan. Ces distinctions permettent aux Canadiennes et Canadiens de mieux comprendre les retombées et l’importance de la recherche, et consolident la position du pays en tant que chef de file de la recherche et de l’innovation sur la scène mondiale.
En apprendre plus sur les gagnants
-
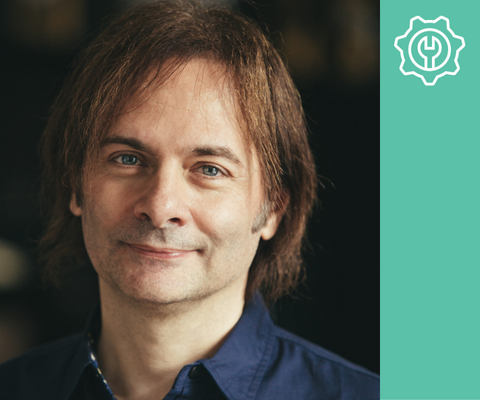 Marco Amabili
Marco AmabiliBourse de recherche Guggenheim
Génie mécanique
Marco Amabili
Un ingénieur en biomécanique a pour objectif de concevoir de meilleures prothèses aortiques
Bourse de recherche Guggenheim
Génie mécaniqueMarco Amabili, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les vibrations et l’interaction fluide-structure au Département de génie mécanique de l’Université McGill, s’est donné comme mission de concevoir des dispositifs pouvant remplacer les prothèses aortiques désuètes utilisées aujourd’hui.
En 2022, il a reçu une Bourse de recherche Guggenheim pour ses travaux sur l’aorte et les greffes de l’aorte, où une partie d’aorte est remplacée par une prothèse en cas de maladie.
« Les prothèses utilisées actuellement sont à vrai dire vieilles et désuètes. Elles ont probablement été conçues par des personnes qui s’intéressaient surtout à la biocompatibilité et à d’autres aspects du dispositif, mais elles ont complètement oublié que la mécanique joue un rôle crucial dans le corps humain. Les prothèses utilisées aujourd’hui présentent de nombreux problèmes sur le plan mécanique. »
M. Amabili est d’avis qu’une nouvelle génération de prothèses doit voir le jour, surtout parce qu’elles sont essentielles à la survie de certaines personnes. « La qualité de vie des gens qui en ont une dépend largement de la qualité des prothèses elles-mêmes, explique-t-il. Ainsi, l’amélioration des prothèses procurera d’énormes avantages aux personnes qui en recevront à l’avenir. »
M. Amabili indique que les prothèses actuelles assurent la survie des patientes et patients, mais qu’elles nécessitent une opération chirurgicale de suivi tous les 10 à 15 ans. « Ce n’est pas idéal, puisqu’il s’agit d’une grosse opération. Trouver une solution qui ne nécessite pas d’opérations additionnelles au fil des ans et qui n’entraîne pas d’effets secondaires serait avantageux pour les personnes greffées. »
C’est l’ampleur du défi qui a attiré M. Amabili dans ce domaine de recherche. « L’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à m’intéresser à ce domaine, c’est qu’il est très complexe et difficile. »
En plus d’avoir le potentiel d’améliorer la vie des patientes et patients, ses travaux présentent également un important potentiel économique. « Il va sans dire que ce type d’opération requiert énormément de ressources sur les plans financier et des soins de santé. Imaginez que vous devez opérer une personne tous les 15 ans à partir de ses 40 ou 50 ans, plutôt que de ne l’opérer qu’une seule fois au cours de sa vie. En plus, une personne qui bénéficie d’une meilleure qualité de vie est plus active. D’un point de vue économique, il y a de nombreux avantages. » Le fait de concevoir ces prothèses améliorées au Canada pourrait d’ailleurs en être un.
Au sujet de l’obtention d’une bourse de recherche Guggenheim, M. Amabili estime qu’il s’agit de distinctions importantes puisqu’elles donnent de la visibilité aux personnes qui les reçoivent ainsi qu’à leurs travaux de recherche. « C’est important parce qu’elles permettent d’obtenir des ressources plus facilement, de recruter de meilleures étudiantes et de meilleurs étudiants aux cycles supérieurs et d’obtenir de meilleurs résultats. »
-
 Karen Bakker
Karen BakkerBourse de recherche Guggenheim
Géographie
Karen Bakker
Une chercheuse de la University of British Columbia met des outils numériques au service de grands enjeux environnementaux
Bourse de recherche Guggenheim
GéographieKaren Bakker, professeure de géographie à la University of British Columbia, dirige le Smart Earth Project, qui vise à déterminer la manière dont les outils numériques sont utilisés pour répondre aux grands défis environnementaux comme les changements climatiques et la perte de la biodiversité.
Situés au croisement de la transformation numérique et de la gouvernance environnementale, ces travaux de recherche transformationnels ont valu à Mme Bakker l’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim de 2022 et figurent dans son dernier ouvrage intitulé The Sounds of Life : How Digital Technology Is Bringing Us Closer to the Worlds of Animals and Plants.
Ses travaux se caractérisent également par une grande interdisciplinarité. « J’ai une formation à la fois en sciences naturelles et en sciences humaines, et j’intègre ces diverses perspectives à tous mes projets », explique-t-elle.
Le plus souvent axés sur des enjeux liés à l’eau, y compris sur la gouvernance pour la sécurité de l’eau, ses travaux portent des champs d’application, mais aussi une vision globale : « Je prends un pas de recul et j’observe les tendances dans de multiples domaines d’activité savante, des activités de recherche à l’innovation ».
Mme Bakker estime qu’une révolution numérique en matière de gouvernance environnementale est amorcée, et qu’elle comprend le passage d’un manque à une hyperabondance de données de même que l’émergence de nouveaux outils comme les algorithmes d’intelligence artificielle. Ces avancées permettent une surveillance environnementale en temps réel, ce qui signifie que les organismes de protection de la nature peuvent plus facilement détecter, limiter et même prévenir les dommages environnementaux.
« Par exemple, des scientifiques ont recouru à la bioacoustique numérique pour localiser en temps réel la baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce hautement menacée. L’information obtenue sert à créer des zones mobiles de protection marine, qui exigent que les navires réduisent leur vitesse ou évitent carrément le secteur. On diminue ainsi le nombre de collisions, un grand facteur de blessures et de décès chez les baleines. »
« On peut aussi citer les satellites servant à détecter les panaches de méthane en temps réel. On arrive maintenant à savoir où sont les émettrices et émetteurs principaux de méthane, n’importe où dans le monde et à tout moment. S’il y a une volonté politique de le faire, on peut même leur faire payer ces émissions fugitives auparavant intraçables. »
Mais tout nouvel outil n’est pas sans risques. « N’importe quelle technologie peut devenir outil ou arme. Ces mêmes technologies que j’ai citées pourraient servir à la chasse de précision. Aussi devons-nous absolument baliser ces risques, tout en autorisant l’utilisation des technologies pour protéger la biodiversité et atténuer le changement climatique. »
Quant à la Bourse de recherche Guggenheim, Mme Bakker voit en cette récompense quelque chose de spécial. « Il faut parfois des années pour faire germer des travaux universitaires. Pour employer une métaphore biologique, la bourse Guggenheim vient souvent jeter la lumière sur des travaux sur le point d’éclore. Je pense donc que cette récompense vient célébrer ces projets qui mettent du temps avant de donner des fruits, mais qui portent une volonté réelle de dire quelque chose de nouveau et d’apporter à la fois une contribution savante et une contribution pour le bien ou le savoir collectif. C’est, je pense, dans ce mélange que réside leur beauté. »
-
 Yoshua Bengio
Yoshua BengioPrix Princesse des Asturies
Informatique
Yoshua Bengio
Un pionnier de l’apprentissage profond veut combler l’un des écarts en intelligence artificielle
Prix Princesse des Asturies
Informatique« Je suis toujours aussi passionné », affirme Yoshua Bengio lorsqu’on lui demande ce qui se profile à l’horizon dans ses travaux de recherche. « Lorsqu’on regarde ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), il y a encore une grande lacune. » On cherche encore des réponses à des mystères de la conscience humaine, explique-t-il.
« C’est un écart qui ne pourra être comblé simplement par plus de travail en génie informatique ou de calculs, ou par l’expansion de nos modèles. Il nous manque des principes, » poursuit le professeur de l’Université de Montréal.
« C’est ce qui oriente mes travaux. Notre hypothèse actuelle, c’est qu’il y a un lien à établir avec le fonctionnement de haut niveau, c’est-à-dire ce qu’on fait consciemment et qu’on peut verbaliser. »
M. Bengio s’est mérité en 2022 un prestigieux prix Princesse des Asturies en recherche technique et scientifique, de pair avec ses collègues Geoffrey Hinton (University of Toronto), Yann LeCun (Université de New York) et Demis Hassabis (DeepMind), tous considérés comme des pionniers de l’apprentissage profond.
Il est fondateur et directeur scientifique de l’Institut québécois d’intelligence artificielle Mila, un regroupement de plus de 1 000 chercheuses et chercheurs de l’apprentissage automatique et le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. M. Bengio est aussi codirecteur du programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR et directeur scientifique d’IVADO, un institut de recherche et de transfert en IA.
L’apprentissage profond s’appuie sur des réseaux de neurones pour exécuter des opérations de reconnaissance vocale, de vision par ordinateur et de traitement du langage. Il a permis à des machines de battre des championnes et champions mondiaux de jeux d’esprit et a révolutionné la biologie en permettant de prédire des structures protéiques à partir de leurs séquences. L’apprentissage profond a pour objectif d’imiter le fonctionnement du cerveau humain et utilise des algorithmes qui convertissent le processus d’apprentissage organique en formule mathématique compréhensible par un ordinateur. Le but est que la machine puisse apprendre de ses propres expériences.
Selon M. Bengio, l’apprentissage profond arrive aujourd’hui à très bien faire ce que les êtres humains font inconsciemment, sans y penser. Le fonctionnement mathématique des idées conscientes qui guident nos actions est toutefois encore imprégné de mystère pour les scientifiques.
« On en sait beaucoup sur le cerveau, on a beaucoup d’indices, et c’est ce qui a inspiré l’apprentissage profond; mais pour espérer faire évoluer la prochaine génération de systèmes d’IA, on devra y intégrer d’autres pans de l’intelligence humaine qui relèvent de processus cognitifs de plus haut niveau. C’est ce qui manque actuellement, selon moi. »
Ses travaux avant-gardistes en apprentissage profond ont aussi valu à M. Bengio un prix Turing en 2018, un prix considéré comme le « prix Nobel de l’informatique », aux côtés de M. Hinton et M. LeCun.
Selon M. Bengio, les avancées et les contributions du Canada en IA sont impressionnantes. « La croissance du milieu canadien de l’IA et les travaux scientifiques accomplis sont remarquables. Au cours des dernières années, le Canada a su attirer des sommités de partout dans le monde. » Il note que c’est grâce à des investissements publics importants dans les dernières années que le pays a pu devenir un chef de file mondial de l’IA.
« Ici à Montréal, on a rassemblé une masse critique phénoménale de personnes spécialisées en IA, particulièrement en apprentissage profond, soit la discipline qui cumule le plus de réussites, qui est la plus emballante, qui génère le plus d’investissements et qui est le plus déployée dans de nombreux secteurs. »
Photo : Camille Gladu-Drouin
-
 Elena Bennett
Elena BennettBourse de recherche Guggenheim
Agriculture et science de l’environnement
Elena Bennett
Bien plus qu’une simple ferme : une chercheuse de l’Université McGill explore l’agriculture multifonctionnelle
Bourse de recherche Guggenheim
Agriculture et science de l’environnementElena Bennett, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sciences de la durabilité à l’Université McGill, étudie l’agriculture multifonctionnelle au Canada. Elle est motivée par le désir de protéger les paysages fonctionnels iconiques, mais souvent négligés, qui contribuent à la biodiversité, offrent des endroits récréatifs et permettent de contrôler les inondations, tout en permettant d’établir des liens historiques et de favoriser un sentiment d’appartenance.
Mme Bennett cherche à savoir où se trouvent les paysages les plus multifonctionnels du Canada et comment ils sont devenus ainsi. Ses travaux lui ont valu l’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim en 2022.
« J’entends par paysages multifonctionnels des endroits où est pratiquée une agriculture qui répond à de multiples besoins et qui procure de multiples avantages, mais qui est souvent oubliée lorsqu’on pense aux paysages agricoles, explique-t-elle. Ces endroits produisent de la nourriture, mais ils sont également jolis à regarder. Ils peuvent stocker du carbone et contribuer à réguler les changements climatiques, retenir les nutriments dans le sol, servir d’habitat pour une variété d’espèces, et plus encore. L’une des choses que je tente de faire dans le cadre de mes travaux, c’est de dévoiler la magie qui permet à ces paysages multifonctionnels de servir à autant de choses. »
La Bourse de recherche Guggenheim lui permettra de rédiger un ouvrage sur le sujet tout en poursuivant ses travaux de recherche. « Le livre examinera un peu plus en détail le rôle des êtres humains comme une force positive pour l’environnement. Dans le mouvement écologique, on entend souvent le discours selon lequel les êtres humains sont nuisibles, et que pour protéger l’environnement, il faut bloquer des zones et empêcher les gens d’y aller. Or, ce que je constate lorsque j’observe certains de ces merveilleux paysages multifonctionnels, ce n’est pas qu’ils sont dépourvus d’êtres humains, mais plutôt que les personnes qui s’y trouvent entretiennent une saine relation avec l’environnement. »
Mme Bennett est coprésidente du Programme sur le changement des écosystèmes et la société et directrice fondatrice du réseau ResNet du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, un réseau pancanadien visant à améliorer la gestion des paysages fonctionnels pour offrir de multiples services écosystémiques.
L’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim « est pour moi la confirmation que ce que j’ai fait est important et que ce que je propose de faire est perçu comme étant pertinent, à tout le moins pour une personne », conclut-elle.
-
 Gilles Brassard
Gilles BrassardPrix Breakthrough
Informatique
Gilles Brassard
Un chercheur en informatique obtient la plus grande distinction scientifique mondiale pour ses travaux en information quantique
Prix Breakthrough
InformatiqueGilles Brassard, professeur à l’Université de Montréal et sommité mondiale en cryptographie quantique, s’est vu décerner un prestigieux prix Breakthrough en physique fondamentale de 2023, soit la plus importante récompense scientifique au monde.
Le chercheur en informatique partage le prix, d’une valeur de trois millions de dollars américains, avec ses collègues Charles H. Bennett (IBM Research), David Deutsch (Université d’Oxford) et Peter Shor (Institut de technologie du Massachusetts), récompensant leurs « travaux fondamentaux en information quantique ».
En 1984, M. Brassard et M. Bennett, un physicochimiste, ont mis au point le premier protocole de cryptographie quantique – un schéma de chiffrement impénétrable – afin de protéger les échanges de données.
L’importance de leurs travaux s’est révélée une décennie plus tard lorsque M. Shor, un mathématicien, a découvert qu’un ordinateur quantique hypothétique pouvait percer les systèmes de chiffrement alors utilisés pour protéger les communications Internet.
Les systèmes d’échange de données sont toutefois demeurés intacts suivant la découverte de M. Shor, parce qu’il n’existe pas encore d’ordinateur quantique (du moins, pas à ce que l’on sache). Comme la technologie a rapidement évolué, l’ordinateur quantique ne devrait pas tarder à être mis au point, souligne M. Brassard. La question n’est plus à savoir s’il sera mis au point, mais quand.
Lorsque ce sera le cas, la cryptographie quantique sera le seul moyen fiable de protéger les données numériques, y compris les données financières stockées numériquement. C’est donc dire que MM. Brassard et Bennett ont proposé un remède dix ans avant la découverte de la maladie.
À l’heure actuelle, « la cryptologie quantique a le vent dans les voiles », indique le chercheur au sujet de l’incidence actuelle de la découverte. « Elle est de plus en plus largement étudiée, mise en œuvre et utilisée, et ce, même dans la vie réelle. Personne n’aurait prédit cela il y a dix ans. »
En 1992, MM. Brassard et Bennett ainsi que des partenaires, dont le Canadien Claude Crépeau, ont inventé le concept théorique de la téléportation quantique. Ce phénomène, expérimenté et confirmé par d’autres scientifiques quelques années plus tard, est l’une des notions fondamentales sur lesquelles repose la théorie de l’information quantique.
M. Brassard est un prodige des mathématiques qui a entamé un baccalauréat en informatique à l’âge de treize ans. Il a remporté de nombreuses distinctions, y compris le prix Wolf de physique, considéré comme la récompense la plus importante après le prix Nobel, ainsi que le prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA.
-
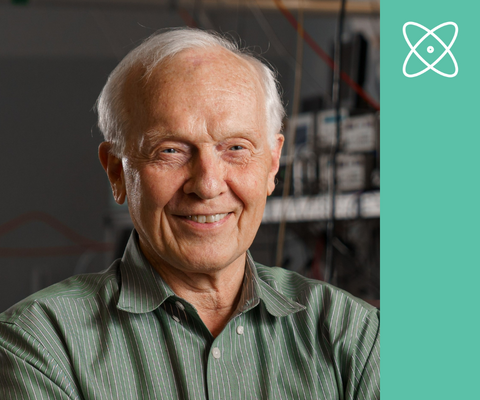 Paul Corkum
Paul CorkumPrix Wolf de physique
Physique
Paul Corkum
Les mesures les plus rapides au monde : un chercheur de l’Université d’Ottawa remporte le prix Wolfe de physique pour ses contributions déterminantes en attophysique
Prix Wolf de physique
PhysiquePaul Corkum, éminent professeur à l’Université d’Ottawa, agent principal de recherche au Conseil national de recherches (CNRC) et co-directeur du Centre conjoint de photonique extrême CNRC-uOttawa, est colauréat du prix Wolf de physique de 2022. Il partage le prix avec ses collègues d’Europe Ferenc Krausz et Anne L’Huillier.
M. Corkum est un pionnier d’une nouvelle branche de la physique qu’on appelle l’attophysique, soit l’étude des processus qui se produisent en un milliardième de milliardième de seconde.
« On a appris comment faire les mesures les plus rapides du monde, 100 fois plus rapidement qu’auparavant », explique-t-il au sujet des travaux qui lui ont valu le prix Wolf. « Au fil du processus, nous avons trouvé une manière de produire des rayons X mous avec des lasers dans des cas où ces derniers étaient auparavant impossibles à utiliser. Il fallait alors utiliser un procédé beaucoup plus compliqué. »
« Nous avons également découvert que lorsqu’on émet une radiation avec de la lumière, il se produit une réaction extrême. »
« C’est comme des vagues, illustre-t-il. Imaginons que l’on va dans la baie de Fundy ou l’océan », propose le Néo-Brunswickois originaire de Saint John, « et que l’on regarde le va-et-vient des vagues. Il y a peut-être une algue sur une roche : la vague viendra chercher l’algue, et la ramènera en l’écrasant sur la même roche. Nous faisons à peu près la même chose avec un atome. »
« La vague, c’est la lumière : une force qui agit sur l’électron tout comme l’eau fait monter et descendre l’algue. Quand la lumière laser frappe un atome, l’électron est libéré de l’atome et bouge avant de revenir s’y écraser, tout comme l’algue s’écrase sur la roche qu’elle vient de quitter. S’il se fait attraper, il émet un faisceau de lumière, ce qui correspond au fracas de l’algue contre la roche. »
« Ce faisceau de lumière correspond aux très courtes pulsations dont je parle », explique-t-il au sujet de ses travaux de recherche fondamentale. « Il y a donc une lumière de haute intensité qui interagit avec des matières, par exemple des atomes (nous avons commencé par ceux-ci) ou des molécules. Nous savons maintenant qu’il est possible de le faire avec des solides transparents, peut-être même avec des métaux. Nous commençons à nous intéresser aux métaux. »
Fils de pêcheur et de capitaine de bateau remorqueur, M. Corkum a passé une grande partie de sa jeunesse près des bateaux, à naviguer avec son père et à travailler avec toutes sortes de moteurs. Il attribue sa carrière à son enseignant de physique à l’école secondaire, Anthony Kennett.
« Il nous disait que quand on lit une équation, il faut penser en dimensions. Il faut penser aux dimensions d’un côté de l’équation, aux dimensions de l’autre côté de l’équation. Si ça ne fonctionne pas, l’équation n’est pas bonne. »
« Je m’étais dit : “C’est vraiment intéressant ». Plus je découvrais le monde de la physique, plus j’aimais ce domaine où la logique est reine. »
-
 Peter Culliis
Peter CulliisPrix international Gairdner Canada
Biochimie et biologie moléculaire
Peter Culliis
Les travaux d’un biochimiste s’intéressant aux nanoparticules lipidiques captivent le monde
Prix international Canada Gairdner
Biochimie et biologie moléculaireAu fil de sa carrière, Pieter Cullis a reçu de nombreuses récompenses internationales pour ses travaux révolutionnaires ayant contribué à la mise au point de vaccins à ARN messager (ARNm) hautement efficaces contre la COVID-19. Sa plus récente récompense, un Prix international Gairdner Canada, revêt toutefois une importance particulière.
« Il s’agit d’un prix canadien, souligne le biochimiste et physicien de la University of British Columbia. Dans cette optique, c’est un réel honneur, parce qu’il s’agit d’une récompense de mon propre pays. »
M. Cullis partage le prix avec Katalin Karikó, vice-présidente principale des traitements par remplacement de protéines ARN à BioNTech SE et professeure associée à l’Université de Pennsylvanie, ainsi que Drew Weissman, directeur de l’Institut Penn pour l’innovation de l’ARN de l’Université de Pennsylvanie. Les trois scientifiques ont mis au point un moyen d’acheminer des médicaments par des ARNm à nucléoside modifié et des nanoparticules lipidiques (LNP), soit les éléments à la base des vaccins à ARNm.
Mme Karikó et M. Weissman ont découvert un moyen de concevoir l’ARNm tandis que M. Cullis a conçu le mécanisme de livraison permettant de l’administrer.
Dans le mécanisme de livraison de l’ARNm, les LNP forment une bulle protectrice qui pénètre les cellules ciblées afin de livrer des instructions génétiques.
M. Cullis s’intéresse à la chimie des lipides et à la formation des LNP depuis quatre décennies. De nouvelles découvertes effectuées dans le cadre de ses recherches ont parfaitement coïncidé avec le besoin d’un vaccin contre la COVID-19, ce qu’il a qualifié « d’être au bon endroit au bon moment ».
Ses travaux liés aux LNP sont également prometteurs pour le traitement de cancers, laissant entrevoir la possibilité de concevoir des traitements hautement personnalisés et relativement non toxiques.
Le chercheur partage en ce moment son temps entre l’enseignement et la recherche à la University of British Columbia et la recherche d’usages commerciaux pour la technologie à base d’ARNm et de LNP. Par l’entremise d’Acuitas, une entreprise de Vancouver qu’il a confondée en 2009, et de NanoVation Therapeutics, une autre entreprise qu’il a confondée en 2019, M. Cullis et des collègues ont collaboré avec des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, des établissements universitaires et des chefs de file de partout dans le monde pour perfectionner et mettre en marché des traitements à base d’ARNm pour une grande variété de maladies.
« Des possibilités émergent actuellement, car nous avons mis au point un processus dûment validé permettant d’introduire des médicaments à base d’acide nucléique dans des cellules cibles in vivo », commente-t-il au sujet des technologies basées sur l’ARNm et les LNP. Le monde entier se tourne vers nous pour concevoir les nombreux nouveaux traitements auxquels cette technologie a ouvert la porte. »
-
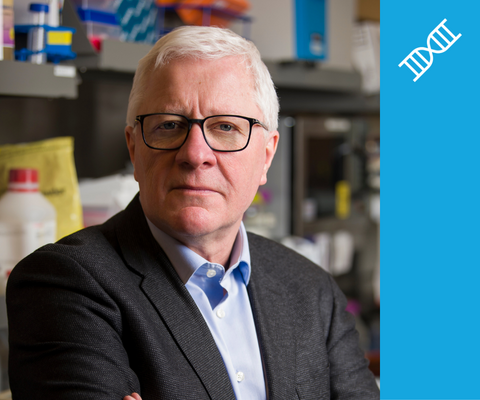 John E. Dick
John E. DickPrix international Canada Gairdner
Génétique moléculaire
John E. Dick
Un chercheur change notre façon de comprendre et de traiter le cancer
Prix international Canada Gairdner
Génétique moléculaireJohn Dick, un pionnier de renommée mondiale en biologie des cellules souches cancéreuses, est lauréat d’un Prix international Canada Gairdner 2022. Ses travaux révolutionnaires sur les cellules souches leucémiques ont transformé notre façon de comprendre, de diagnostiquer et de traiter la leucémie aiguë myéloïde.
« Nos travaux de recherche visent à comprendre ce qui caractérise une cellule souche, et ce qui peut la corrompre », explique le professeur de la University of Toronto.
Depuis plus de trois décennies, les travaux de M. Dick révolutionnent la compréhension de l’hématopoïèse normale et leucémique. Comme scientifique principal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en biologie des cellules embryonnaires au Centre de cancérologie Princess Margaret de Toronto, ses découvertes ont changé les perspectives sur l’origine et la nature du cancer et rendu possible de nouvelles approches en matière de traitement.
On doit à M. Dick la découverte des cellules souches leucémiques chez une personne présentant une leucémie aiguë myéloïde. C’est ainsi qu’il a pu être établi que les cellules cancéreuses ne sont pas toutes égales : seules certaines cellules leucémiques rares peuvent s’autorenouveler, une caractéristique distinctive des cellules souches.
Sa découverte montre que « quand on fait la transplantation sur une souris, seulement une cellule sur un million peut vraiment reproduire la leucémie. C’est ce qui nous conduit à l’idée que la leucémie n’est qu’une caricature du développement normal. On a une cellule souche qui peut régénérer une grande quantité de sang : c’est une cellule puissante. Or, il s’avère que la leucémie fonctionne d’une manière semblable; il existe de rares cellules souches leucémiques qui font que le cancer se développe. »
« Quand nous avons commencé à nous y intéresser de plus près, nous avons constaté que tout comme les cellules souches normales, ces cellules souches leucémiques sont soit en dormance, soit lentes à se reproduire. Cela leur permet d’échapper à la chimiothérapie conventionnelle. C’est pour cette raison que la leucémie semble disparaître, avant de revenir en force à partir de cellules souches leucémiques survivantes. »
La mise au jour de dissemblances entre cellules cancéreuses a marqué « un tournant dans la compréhension et l’étude du cancer. » C’est ce qui a mené à l’exploration de cellules souches dans d’autres cancers humains (sein, cerveau, côlon, pancréas, peau, foie).
Les travaux de M. Dick montrent l’importance d’éradiquer en thérapie les cellules souches cancéreuses, et de mettre au point des traitements qui ciblent les failles de ces cellules.
Même s’il a toujours travaillé dans des laboratoires de recherche, celui de l’hôpital pour enfants SickKids, à Toronto, a donné un sens à sa carrière dès le début. Quand il traversait le bâtiment, il passait devant le service d’hématologie et d’oncologie.
« Je voyais des enfants, parfois très malades, sans cheveux, déambulant avec leur soluté. On pouvait voir les ravages causés par le cancer; ça nous mène vraiment à canaliser nos efforts. Chaque jour, on voit la même scène, et on comprend que ce travail n’est pas qu’abstrait, c’est bien plus qu’une énigme à résoudre : il fait vraiment une différence. »
« Et quand on mesure l’importance de ce travail, il y a un impératif qui s’impose : on sait combien c’est important et qu’il faut continuer. Il y a aussi un sentiment d’urgence qui s’installe, où on s’oblige à faire mieux. Il y a encore trop d’échecs de traitement pour trop de personnes, et il faut améliorer ça. »
-
 David Duvenaud
David DuvenaudBourse de recherche Sloan
Informatique
David Duvenaud
Un chercheur en informatique travaille sur des modèles génératifs en apprentissage profond
Bourse de recherche Sloan
InformatiqueDavid Duvenaud, professeur adjoint en informatique à la University of Toronto, est lauréat d’une Bourse de recherche Sloan de 2022 pour ses travaux de recherche en apprentissage profond.
Ses travaux, explique-t-il, visent à concevoir des modèles génératifs, lesquels peuvent en principe, contrairement aux classifieurs ou aux prédicteurs décisionnels, répondre à n’importe quelle question dans un domaine, en plus de savoir classer ou prédire l’information.
« Par exemple, dans un contexte médical, on pourrait concevoir un classifieur qui prédirait la probabilité d’une maladie d’après toutes les données connues sur une patiente ou un patient. Mais si l’on concevait plutôt un modèle génératif, on pourrait demander la probabilité conjointe de plusieurs maladies en même temps, ou demander quelles sont les données représentatives des patientes et des patients qui présentent la maladie. Cela nous permet de vérifier la qualité du modèle, et de prendre des décisions plus poussées. »
Un modèle génératif, observe-t-il, facilite généralement l’intégration de plusieurs types de données.
M. Duvenaud compte utiliser le financement associé à sa bourse, une subvention de recherche sans restriction, pour permettre à son équipe de créer des « modèles profonds à temps continu en mode natif. »
« Le traitement des données recueillies sur une longue période, comme les dossiers médicaux, s’est généralement fait en divisant le temps entre différentes corbeilles, et en faisant la moyenne de toutes les données contenues dans une même corbeille. Si elle est typiquement simple et rapide, cette manière de faire exige d’écraser les données dans un format préétabli, avant même que le modèle puisse les saisir. À la place, nous élaborons des modèles qui pourront intégrer les données dans un format beaucoup plus brut. Il faut pour cela que la configuration soit un peu plus réfléchie, et le fait qu’on utilise un modèle génératif exige une étape de plus, appelée l’inférence approximative. Il faut toutefois reconnaître que ces méthodes complexes reposaient beaucoup sur les épaules des utilisatrices et utilisateurs, qui devaient se charger de leur propre prétraitement. On tente donc en quelque sorte d’automatiser la démarche de modélisation scientifique. »
Au sujet de la Bourse de recherche Sloan, M. Duvenaud déclare : « J’ai accepté, il y a deux ans, que je ne l’aurais jamais. J’avais atteint l’âge maximal d’admissibilité. Mais l’an dernier, les règles ont changé pour inclure quiconque n’a pas obtenu sa permanence. Je suis particulièrement reconnaissant envers les personnes qui m’ont aidé en écrivant des lettres, à qui j’ai eu l’odieux de demander un coup de main assez chronophage. »
Il souligne que ce type de prix aide à « présenter au monde extérieur des personnes qui sont perçues comme étant productives et générant des retombées dans leur domaine. »
-
 Lenore Fahrig
Lenore FahrigPrix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA
Biologie
Lenore Fahrig
Une pionnière en fragmentation du paysage remporte un prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA
Prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA
BiologieLenore Fahrig, professeure de biologie à la Carleton University, s’est vu décerner un prestigieux prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA en 2022 pour ses contributions au domaine de l’écologie spatiale. Mme Fahrig s’intéresse aux incidences de la fragmentation des habitats et de la rupture de liens entre les zones résiduelles sur la biodiversité.
Elle partage le prix, d’une valeur de 400 000 euros, avec deux autres écologistes, Simon Levin et Steward Pickett, pour leurs travaux intégrant la dimension spatiale à la recherche sur les écosystèmes.
Les études de Mme Fahrig sur la fragmentation du paysage visent à répondre aux questions pratiques suivantes : est-ce préférable d’aménager une grande aire protégée, ou plutôt de multiples aires de petite taille? Devrait-on créer des « corridors écologiques » entre les aires protégées? Comment la disposition des routes affecte-t-elle les écosystèmes?
Le comité de sélection souligne que la lauréate a su « mettre au point des moyens fondés sur la théorie et les données pour véritablement atténuer les effets de la perte d’habitats grâce à la conservation de la connectivité. « Ses études mettent en lumière le rôle central des réseaux de routes et des petites aires protégées dans la modification de la répartition et de la quantité des espèces ».
Par ses travaux sur l’incidence de la structure du paysage sur la quantité, la répartition et la persistance des organismes, la scientifique a pu démontrer l’importance des petites zones protégées. Comme la structure du paysage est lourdement affectée par l’activité humaine, comme la foresterie, l’agriculture ou le développement, les conclusions de ses études servent à la prise de décisions liées à l’aménagement du territoire.
« On a tendance à croire que les grandes espèces ou celles en voie de disparition se portent mieux dans un vaste espace, comme les espèces qui évoluent mieux à l’intérieur d’une forêt par exemple, explique-t-elle. L’idée semble logique, car si vous avez dix petits espaces, vous aurez davantage de zones limitrophes et moins de zones de forêt intérieure nécessaires à la survie de ces espèces. Pour cette raison, certaines personnes croient qu’il y a davantage de biodiversité dans un grand espace plutôt que dans de nombreux petits espaces. »
« Voilà qui est problématique, parce que si l’on assume qu’il y a peu de biodiversité dans les petites zones d’habitat, cela signifie que des milliers de petits espaces ne seront pas protégés, alors qu’ils renferment pourtant une grande variété d’espèces, poursuit la chercheuse. Si ces zones sont détruites, la perte de biodiversité est énorme. »
Mme Fahrig est à l’origine de la création de nouvelles sous-disciplines, comme la conservation de la connectivité. Des centaines d’organisations du monde entier se sont appuyées sur ses travaux de recherche pour améliorer leurs politiques et pratiques de conservation.
Mme Fahrig a également remporté une Bourse de recherche Guggenheim en 2021.
-
 Michael Groechenig
Michael GroechenigBourse de recherche Sloan
Informatique et sciences mathématiques
Michael Groechenig
Un chercheur en mathématiques pures envisage les applications à long terme
Bourse de recherche Sloan
Informatique et sciences mathématiquesLorsqu’il est question des avancées du domaine de la géométrie algébrique au fil des siècles, Michael Groechenig, professeur et mathématicien à la University of Toronto, « les comparerait en quelque sorte à la philosophie ». « Les problèmes que nous tentons de résoudre aujourd’hui proviennent de quelque part. » Le milieu de la recherche s’est heurté à ces problèmes au cours d’un long processus; ils ont leur propre passé. Le domaine a radicalement changé au cours du dernier siècle.
« Les mises en application sont possibles, affirme M. Groechenig, mais seul un petit pourcentage des travaux de recherche en mathématiques mène à des applications concrètes. » Cependant, lorsque c’est le cas, il s’agit habituellement d’une percée majeure.
« Bien souvent, ces applications sont trouvées non pas des décennies plus tard, mais des centaines d’années plus tard. Ainsi, dans un certain sens, j’ai l’impression que la raison d’être d’un spécialiste des mathématiques pures comme moi consiste aussi à préserver ce savoir et à s’assurer que nous n’oublions pas qu’il puisse se perdre. C’est une façon de perpétuer la tradition, de passer le flambeau à la prochaine génération de mathématiciennes et mathématiciens et même aux ingénieures et ingénieures et aux autres personnes qui travaillent peut-être aux mises en application. »
Les travaux de M. Groechenig portent sur les espaces de modules.
Il estime que l’obtention d’une Bourse de recherche Sloan revêt un caractère spécial puisqu’elle représente en quelque sorte l’approbation de ses collègues.
« C’est bien de recevoir de temps à autre des encouragements pour son travail. On passe souvent de longues périodes à ne recevoir que peu de rétroaction. L’échec fait partie intégrante de la recherche. Parfois c’est bon de voir ses réalisations reconnues par ses homologues. »
Photo : Drew Lesiuczok
-
 Dr Gordan Guyatt
Dr Gordan GuyattPrix de la Fondation Einstein pour la promotion de la qualité en recherche
Méthodes de recherche, données probantes et retombées en santé
Dr Gordan Guyatt
Un médecin est récompensé pour ses travaux promouvant la qualité en recherche
Prix de la Fondation Einstein pour la promotion de la qualité en recherche
Méthodes de recherche, données probantes et retombées en santéEn 2022, Gordon Guyatt, professeur à la McMaster University, a obtenu un Prix de la Fondation Einstein pour la promotion de la qualité en recherche pour ses travaux pionniers en médecine fondée sur les données probantes.
Le Dr Guyatt, à qui l’on doit l’expression « médecine factuelle », figure parmi les scientifiques dont les travaux sont les plus cités au monde. Sa première définition de l’expression est parue dans un article publié en 1991. Aujourd’hui, l’expression est utilisée à l’échelle mondiale pour désigner les soins de santé fondés sur les données probantes les plus récentes et de la plus haute qualité.
« En médecine factuelle, il faut procéder à des revues systématiques des meilleures données probantes pour orienter sa pratique », explique-t-il. Dr Guyatt a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de méthodes permettant d’effectuer de bonnes revues systématiques.
« Il s’agit d’un autre moyen de rehausser la qualité en recherche. »
En collaboration avec Andrew Oxman de l’Institut de santé publique de la Norvège et Holger Schunemann, professeur à la McMaster University, le Dr Guyatt a aussi grandement contribué à la mise au point de l’approche GRADE en recherche médicale.
Cette approche propose un cadre pour élaborer et présenter des synthèses de données probantes ainsi qu’une structure permettant de formuler des recommandations de pratique clinique à partir de données probantes. Grâce à cette approche, les prestataires de soins de santé peuvent accéder à des recommandations claires et concises sur le traitement d’une affection donnée, améliorant ainsi les soins médicaux prodigués aux patientes et patients.
Les travaux du Dr Guyatt visant à améliorer la recherche comprennent également d’importantes contributions à la qualité des essais cliniques aléatoires et à l’évaluation de l’état de santé de patientes et patients.
L’approche GRADE est utilisée par plus de 110 organisations à l’échelle mondiale, y compris l’Organisation mondiale de la santé.
-
 Michael J. Hathaway
Michael J. HathawayBourse de recherche Guggenheim
Sociologie et anthropologie
Michael J. Hathaway
Un anthropologue s’intéresse aux origines du mouvement mondial du militantisme politique autochtone
Bourse de recherche Guggenheim
Sociologie et anthropologieGrâce au soutien d’une Bourse de recherche Guggenheim remportée en 2022, l’anthropologue Michael Hathaway pourra se consacrer pendant un an à l’approfondissement de ses travaux de recherche sur la formation de réseaux autochtones sur la côte du Pacifique.
À titre de directeur du Centre David Lam en études asiatiques de la Simon Fraser University, M. Hathaway s’intéresse au déterminisme environnemental mondial ainsi qu’aux droits autochtones en Asie. Ses activités de recherche actuelles portent sur des délégations autochtones ayant visité la Chine depuis le Japon, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans les années 1970. Une fois de retour dans leur pays, ces groupes autochtones ont remis en question les systèmes coloniaux, inspirés par ce qu’ils ont observé en Chine.
M. Hathaway explique que ces délégations étaient reçues sur l’invitation du dirigeant du Parti communiste chinois Mao Zedong. « Il a invité une délégation du Canada, trois du Japon, une de l’Australie et une de la Nouvelle-Zélande. » Partout dans le monde, de nouvelles figures militantes issues de communautés autochtones ont commencé à lire Le petit livre rouge, une compilation de citations du dirigeant du Parti communiste chinois faisant l’apologie d’une version maoïste du socialisme.
« Il a tenté de les convaincre qu’en Chine, les peuples qualifiés de “minorités ethniques” avaient une meilleure situation qu’ailleurs dans le monde. Des délégations ont visité une université bien financée où le corps professoral issu de minorités ethniques enseignait à un groupe étudiant également issu de minorités ethniques, et lisait des livres dans des langues propres à ces minorités. Or, comme rien de tel n’existait dans les pays d’origine des délégations, le tout laissait souvent une forte impression. »
« Ces visites ont commencé à influencer leur point de vue, poursuit M. Hathaway. Plutôt que d’adopter une perspective locale ou nationale, ces groupes ont commencé à se considérer comme des peuples du monde. Certains groupes ont par la suite accueilli des délégations étrangères dans leur pays pour poursuivre leurs travaux communs. »
M. Hathaway, qui se trouve actuellement en Nouvelle-Zélande, où quelques personnes ayant participé à une visite en Chine en 1975 sont toujours en vie, y passera plusieurs mois afin d’étudier les liens du pays avec le mouvement. Le chercheur tente de déterminer l’influence qu’a eue la visite sur les stratégies politiques, les priorités et les objectifs de la délégation.
Au Japon, des efforts de revitalisation des langues ont été entrepris par une délégation de retour de Chine. C’est environ à la même époque que s’est formé au Canada le Conseil mondial des peuples autochtones sous la direction de George Manuel, membre de la Nation secwepemc de la Colombie-Britannique, un regroupement qui s’inscrit dans la foulée du mouvement.
Les travaux de M. Hathaway en Nouvelle-Zélande lui ont d’ailleurs permis d’accéder à des archives témoignant de faits ayant eu lieu au Canada, un avantage inattendu. « C’est fascinant d’avoir pu trouver des archives maories en Nouvelle-Zélande à propos d’événements qui se sont déroulés au Canada, mais qui ne se trouvent dans aucune archive canadienne. »
-
 Geoffrey Hinton
Geoffrey HintonMédaille de la Société royale du Royaume-Uni
& prix Princesse des AsturiesInformatique
Geoffrey Hinton
Un précurseur de l’intelligence artificielle explore un nouveau type d’algorithme d’apprentissage profond
Médaille de la Société royale du Royaume-Uni
& prix Princesse des Asturies
InformatiqueUn précurseur du domaine de l’intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a remporté deux prestigieuses distinctions internationales en recherche en 2022, soit une médaille de la Société royale du Royaume-Uni et un prix Princesse des Asturies en recherche scientifique et technique. Le professeur émérite de la University of Toronto partage le prix Princesse des Asturies avec trois autres sommités en apprentissage profond, une branche de l’intelligence artificielle, soit Yoshua Bengio (Université de Montréal), Yann LeCun (Université de New York) et Demis Hassabis (DeepMind).
Ses travaux révolutionnaires en apprentissage profond, qui vise à reproduire la manière dont l’être humain acquiert certaines connaissances, ont stimulé le progrès dans de nombreuses sphères.
« J’essaie de comprendre la manière dont le cerveau apprend, explique-t-il au sujet de ses travaux de recherche. Les différentes tentatives visant à comprendre la mécanique d’apprentissage du cerveau se sont révélées utiles en ingénierie. »
« L’algorithme de rétropropagation, notamment, est à l’origine de la formation de presque tous les grands réseaux neuronaux. » Le chercheur explique que la rétropropagation était d’abord une hypothèse sur la façon dont le cerveau acquiert des connaissances, mais à présent, personne ne sait si le cerveau effectue véritablement de la rétropropagation.
« Et je pense qu’il n’en fait pas, admet-il. C’est pourquoi j’estime que la technologie actuelle fonctionne différemment du cerveau, mais que le principe peut certainement être fort utile en ingénierie. Tous ces grands modèles de langage et de vision artificielle ont recours à la rétropropagation. »
M. Hinton indique de la rétropropagation fonctionne uniquement si le réseau neuronal possède un parfait modèle de lui-même. « Je crois que le cerveau n’en possède pas, avance-t-il, et que le matériel analogique n’y parviendra pas. Donc, si l’on veut apprendre par l’entremise de matériel analogique, il faudra mettre au point un autre type d’algorithme. »
La réponse à ce problème est l’objet des études actuelles menées par M. Hinton.
« On se demande quel type d’algorithme d’apprentissage peut utiliser le matériel analogique. Le cerveau est de toute évidence doté d’un très bon algorithme d’apprentissage, mais il n’est peut-être pas aussi sophistiqué que celui des réseaux neuronaux profonds actuels. »
« Pendant une longue période, l’objectif était de mettre au point des réseaux neuronaux artificiels aussi performants que les réseaux humains. Selon moi, les réseaux artificiels fonctionneront mieux que leur équivalent humain. »
M. Hinton est aussi conseiller scientifique en chef à l’Institut Vecteur pour l’intelligence artificielle ainsi que vice-président et ingénieur associé à Google. En 2018, il a remporté le prix Turing, souvent considéré comme le « prix Nobel en informatique ».
-
 Alec Jacobson
Alec JacobsonBourse de recherche Sloan
Informatique
Alec Jacobson
Un chercheur en informatique perfectionne les applications du traitement de maillages
Bourse de recherche Sloan
InformatiqueLe chercheur en informatique Alec Jacobson de la University of Toronto a remporté en 2022 une Bourse de recherche Sloan pour ses contributions en matière de traitement de maillages, une technique qui trouve ses applications autant en simulation climatique, en biomédecine et en robotique qu’en architecture.
« Tout repose sur la manière de représenter des formes à deux et trois dimensions à l’ordinateur, pour ensuite les manipuler, les analyser et espérer leur trouver une application concrète », explique M. Jacobson.
« Le traitement de maillages est issu de l’infographie, où les formes peuvent revêtir l’aspect de personnages ou de décors, ou encore d’effets visuels ou de jeux vidéo. Le procédé est également utilisé en fabrication numérique ou en conception d’objets ou d’équipements, y compris en soins de santé et en sciences médicales, lorsque l’on doit représenter l’anatomie humaine ou des parties du corps. »
« Il faut s’assurer que les algorithmes que nous créons sont en mesure de déchiffrer les données désordonnées recueillies sur le terrain. Il existe heureusement d’excellents moyens de recueillir des données pour la géométrie tridimensionnelle. Désormais, même les téléphones cellulaires permettent de récolter des données 3D. Par contre, le tout génère beaucoup de données inutiles pouvant causer des problèmes aux algorithmes existants, et c’est pourquoi la majorité du travail consiste à s’assurer que les algorithmes fonctionnent correctement avec des données désordonnées. »
M. Jacobson révèle que l’obtention d’une Bourse de recherche Sloan fut une grande surprise, puisqu’il a présenté sa candidature à quelques reprises sans qu’elle soit retenue.
« C’est toujours décevant de voir sa candidature rejetée, admet-il. Les exigences quant au nombre d’années écoulées depuis l’obtention d’un doctorat par les candidates et candidats ont été assouplies, et j’ai pu présenter à nouveau une demande. L’obtention de cette bourse est à la fois un réel honneur et une expérience vertigineuse, car la liste des lauréates et lauréats précédents fixe la barre très haut. »
Le chercheur compte utiliser les fonds associés à la bourse pour embaucher des doctorantes et doctorants et leur offrir un salaire compétitif. Il ajoute que le financement permettra aussi à lui et à des membres de son équipe d’assister à des conférences pour diffuser les résultats de leurs travaux de recherche.
-
 Victoria Kapsi
Victoria KapsiPrix mondial des sciences Albert-Einstein
Astronomie
Victoria Kapsi
Une astrophysicienne étudie les mystérieux sursauts radio rapides
Prix mondial des sciences Albert-Einstein
AstronomieVictoria Kaspi, professeure à l’Université McGill et sommité mondiale de l’étude des étoiles à neutrons, a remporté le Prix mondial des sciences Albert-Einstein en 2022. Directrice de l’Institut spatial Trottier de McGill, Mme Kaspi a contribué à faire du Canada un chef de file mondial en astrophysique.
Le Prix mondial des sciences Albert-Einstein lui a été accordé principalement en reconnaissance de ses travaux portant sur les magnétoiles, de jeunes étoiles à neutrons disposant d’un champ magnétique considérable qui émettent des rayons X et des rayons gamma de haute intensité.
« Ce sont des objets spectaculaires et très intéressants, dit-elle. J’ai adoré les étudier, et c’est ce que j’ai fait pendant au moins une quinzaine d’années. »
Plus récemment, Mme Kaspi s’est intéressée aux sursauts radio rapides, des émissions soudaines d’ondes radio de durée variant d’une fraction de milliseconde à trois secondes qui proviennent de sources à l’extérieur de la galaxie de la Terre. Le processus astrophysique qui en est à l’origine est encore incompris. On estime que les sursauts radio rapides produisent en une milliseconde autant d’énergie que le soleil en produit en trois jours.
Mme Kaspi dirige le projet de sursauts radio rapides CHIME qui, à l’aide du télescope CHIME, a permis d’en détecter davantage qu’avec tous les autres types de radiotélescopes réunis.
Au sujet de l’obtention du Prix mondial des sciences Albert-Einstein, la chercheuse affirme qu’il est parfois « embarassant » d’être choisie comme lauréate d’un prix parce que ses réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe. « Il n’en demeure pas moins que ces reconnaissances procurent de nombreux avantages tangibles pour mon projet de recherche et, du même coup, pour la recherche canadienne. » Cela comprend, ajoute-t-elle, celui de faciliter le recrutement d’étudiantes et d’étudiants, et de postdoctorantes et postdoctorants pour son équipe.
« Je crois également que ça rehausse d’un cran les critères d’excellence pour tout le monde et permet de faire venir au Canada des personnes fantastiques qui ne seraient peut-être jamais venues autrement. Parfois, elles décident de s’y établir et de lancer leurs propres projets de recherche. C’est tout simplement formidable pour le pays. »
-
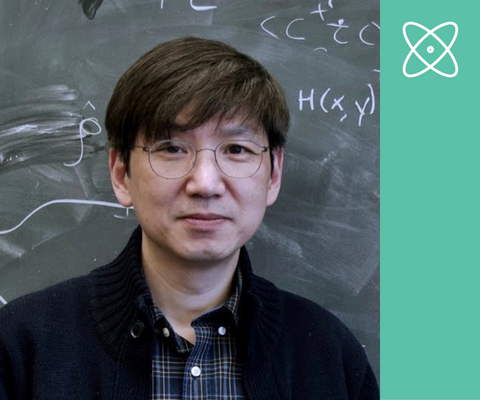 Yong Baek Kim
Yong Baek KimBourse de recherche Guggenheim
Physique
Yong Baek Kim
Un chercheur en matériaux quantiques remporte la seule Bourse de recherche Guggenheim en physique décernée en 2022
Bourse de recherche Guggenheim
PhysiqueYong Baek Kim, professeur à la University of Toronto, a remporté une Bourse de recherche Guggenheim en 2022 pour ses travaux sur les nouvelles propriétés des matériaux quantiques. Les activités de recherche de M. Kim, qui est également directeur du Centre de matériaux quantiques de l’Université, portent sur la physique théorique de la matière quantique condensée, à savoir l’étude de la matière et de son comportement exotique lorsque des électrons, tel qu’ils sont représentés par le modèle quantique de l’atome, sont assujettis à des conditions extrêmes comme de basses températures ou une pression élevée.
« Nous tentons d’élucider des propriétés physiques émergentes difficilement compréhensibles, explique M. Kim. Dans le cas de nombreux matériaux, les interactions entre les électrons sont d’une importance fondamentale, et même si l’on comprend le mouvement d’un seul électron, on ne peut prédire les mouvements d’un grand nombre d’entre eux. »
Les travaux de M. Kim pourraient servir aux technologies quantiques, y compris à l’informatique quantique. Ses principales contributions comprennent l’élaboration de la théorie des liquides de spin quantiques dans des matériaux quantiques à fort couplage spin-orbite ainsi que des propositions théoriques liées à la détection expérimentale de nouvelles quasi-particules dans des phases quantiques organisées selon leur topologie, qui pourraient servir à des technologies quantiques futures.
M. Kim est le seul chercheur à avoir reçu une Bourse de recherche Guggenheim en physique en 2022.
-
 Alexander Kupers
Alexander KupersBourse de recherche Sloan
Informatique et sciences mathématiques
Alexander Kupers
La Fondation Sloan souligne les activités de recherche en topologie
Bourse de recherche Sloan
Informatique et sciences mathématiquesGrâce à ses travaux de recherche en topologie, soit les mathématiques des figures géométriques, Alexander Kupers, chercheur à la University of Toronto à Scarborough, s’est vu décerner une Bourse de recherche Sloan.
Selon lui, un aspect surprenant de la topologie est le fait que les figures simples, comme les disques et les sphères, peuvent en fait présenter des symétries complexes.
« En principe, si vous maîtrisez la symétrie d’une certaine figure, alors vous comprenez très bien cette figure, explique-t-il. Vous pouvez ensuite utiliser cette symétrie pour comprendre tous les problèmes dans lesquels est comprise cette figure. »
« En étudiant ces figures, surtout en hautes dimensions, on réalise qu’une multitude de rapprochements intéressants peuvent être établis avec d’autres branches des mathématiques, ou avec la physique théorique. »
M. Kupers se réjouit de l’obtention de la Bourse : « C’est un honneur de remporter une distinction de ce calibre. Bon nombre de mathématiciennes et mathématiciens d’exception ont obtenu une Bourse de recherche Sloan par le passé. »
Le chercheur compte utiliser les fonds de la Bourse de recherche Sloan pour embaucher d’autres postdoctorantes et postdoctorants et favoriser un environnement de recherche offrant un meilleur soutien aux doctorantes et doctorants de son équipe de recherche.
-
 Geoff Mann
Geoff MannBourse de recherche Guggenheim
Géographie
Geoff Mann
Affronter un avenir incertain : un chercheur de la Simon Fraser University explore la manière dont la société compose avec les défis
Bourse de recherche Guggenheim
GéographieLe spécialiste de la géographie humaine Geoff Mann a remporté une Bourse de recherche Guggenheim en 2022 pour ses travaux sur la science et l’économie des changements climatiques. Directeur du Centre d’économie politique mondiale de la Faculté de l’environnement de la Simon Fraser University, M. Mann étudie l’incertitude à laquelle les êtres humains sont confrontés aujourd’hui, particulièrement celle entourant les changements climatiques, ainsi que l’évolution de la manière dont ils tentent de composer avec elle, que ce soit sur les plans politique, économique, institutionnel ou culturel.
« Je m’intéresse tout particulièrement à l’incertitude au sens large. Nous vivons à une époque où l’avenir semble de moins en moins reluisant, surtout avec les problèmes découlant des changements climatiques. Le passé peut de moins en moins nous fournir les outils dont nous avons besoin pour l’affronter puisqu’il est de plus en plus différent de ce que nous avons déjà vécu. »
M. Mann examine la manière dont les économistes, les responsables politiques, les scientifiques et la classe politique tentent de composer avec cette incertitude. Il pense que les mouvements « réactionnaires d’extrême droite » observés actuellement sont motivés par le désir de certaines personnes d’arrêter le temps et de retrouver la prévisibilité réconfortante d’un temps passé.
« Je m’intéresse au capitalisme, dit-il, en particulier à sa théorie, à son histoire, à ses politiques et à son économie. » Récemment, son attention s’est tournée vers le problème des changements climatiques et la manière dont la pensée économique est utilisée pour élaborer ou gérer des politiques destinées à s’y attaquer.
« Je suis très critique du rôle de l’économie à cet égard, car je pense qu’elle n’a en fait qu’un effet placebo, explique-t-il. Elle apaise faussement les inquiétudes et laisse croire que nous avons des réponses, alors qu’elles sont en fait largement insuffisantes pour régler le problème. »
Au cours des dernières années, M. Mann s’est exprimé dans la presse au sujet des approches économiques qui, à son avis, devraient servir de normes dans tous les domaines, y compris l’inégalité, la politique monétaire et les changements climatiques. Grâce au soutien de la Bourse de recherche Guggenheim, il travaillera à la rédaction d’un nouvel ouvrage sur les vaines tentatives de la société pour composer avec l’incertitude actuelle.
-
 Claudia Mitchell
Claudia MitchellPrix mondial de l’éducation José-Vasconcelos
Éducation
Claudia Mitchell
Une professeure démontre que les petits projets peuvent mener à de grands changements sociaux
Prix mondial de l’éducation José-Vasconcelos
ÉducationLa professeure Claudia Mitchell de l’Université McGill a reçu le Prix mondial de l’éducation José-Vasconcelos en 2022 en reconnaissance de son engagement de longue date envers l’éducation comme un moyen de transformer la vie des jeunes, particulièrement les jeunes provenant de groupes marginalisés.
Le comité de sélection a salué les travaux de Mme Mitchell visant à régler des problèmes sociaux épineux qui touchent les filles dans divers pays, ses projets novateurs et adaptatifs couronnés de succès ainsi que ses activités d’enseignement et de recherche.
« Comme je m’intéresse beaucoup aux enjeux de justice sociale, explique Mme Mitchell, je travaille surtout sur les questions d’équité entre les genres, de violence fondée sur le genre ainsi que de l’augmentation du nombre de filles fréquentant l’école, mais aussi sur la manière de susciter la participation des garçons et des jeunes hommes à ce type d’enjeux. »
Elle a souvent recours à la cinématographie dans le cadre de ses projets, utilisant principalement des téléphones cellulaires pour faire des vidéos. « Nous faisons également de la recherche par amorce photo et utilisons des photos ou des dessins pour explorer des enjeux difficiles à expliquer, mais souvent beaucoup plus percutants en images. »
La participation des collectivités fait partie intégrante des travaux de Mme Mitchell. « Il est très important de faciliter le dialogue et de collaborer avec elles. »
Une grande partie de son travail se déroule en Afrique subsaharienne. « À l’heure actuelle, nous faisons beaucoup de travail en Sierra Leone, où on dénote des problèmes particulièrement importants en ce qui a trait au genre », affirme-t-elle.
Mme Mitchell estime que l’obtention du Prix mondial de l’éducation José-Vasconcelos renforce la valeur de ses travaux. Elle indique aussi aux jeunes chercheuses et chercheurs que ce type de recherche en vaut la peine et que c’est parfois en travaillant avec un petit nombre de personnes qu’on peut susciter le changement.
Elle donne un exemple : « En Afrique du Sud, dix filles ont mené un projet dans le cadre duquel elles ont réalisé des films sur pellicule au sujet du mariage forcé et précoce. Les membres de leur communauté les ont vus, et le chef et d’autres personnes ont décidé de changer les choses. Ces personnes se sont rendues à l’Assemblée législative de Pietermaritzburg et ont réussi à faire entériner un protocole au sujet des mariages forcés et précoces dans une région. »
« Ces retombées sont très importantes, tout comme le fait que les gens en soient témoins, puisqu’elles témoignent de la valeur de ce genre de travail. »
-
 Nicolas Papernot
Nicolas PapernotBourse de recherche Sloan
Génie électrique et informatique
Nicolas Papernot
Un chercheur décèle des erreurs en intelligence artificielle afin de renforcer la confiance du public
Bourse de recherche Sloan
Génie électrique et informatiquePour que l’intelligence artificielle (IA) atteigne son plein potentiel en matière de bienfaits pour la société, elle doit gagner la confiance du public. Le renforcement de cette confiance est l’objet de recherche du chercheur en informatique Nicolas Papernot, lauréat d’une Bourse de recherche Sloan en 2022.
« Je m’intéresse essentiellement aux liens entre l’IA, ou l’apprentissage automatique, et la sécurité informatique, la confidentialité et la confiance en général, explique le professeur de la University of Toronto. Mon équipe et moi tentons d’élucider les raisons pour lesquelles les algorithmes d’apprentissage automatique échouent dans le but d’améliorer la confiance des humains et de la société en général envers ces algorithmes lorsqu’ils sont déployés et qu’on doit se fier à leurs prévisions. »
Par exemple, l’apprentissage automatique permet de reconnaître la voix humaine lorsque l’on s’adresse à une assistance virtuelle au téléphone, ou encore à des haut-parleurs intelligents. « Dans l’une de nos études, nous avons découvert que si vous vous adressez à une assistance vocale en parlant à travers un tube, cette dernière associera votre voix à celle d’une autre personne. Vous pouvez même ajuster la longueur du tube pour faire croire au modèle d’apprentissage que vous êtes une personne précise. »
« Voilà qui démontre que les algorithmes d’apprentissage ont des façons bien différentes de déchiffrer les modèles perçus dans les données traitées, comparativement à l’être humain. Il y a donc une sorte d’écart sémantique entre la manière dont ils formulent leurs prévisions et la manière dont des entités malveillantes peuvent exploiter le tout. »
L’équipe de M. Papernot a également été en mesure de démontrer que, dans certaines circonstances, un classificateur d’images pourrait confondre un panneau d’arrêt avec un panneau de cession de passage.
Les activités de recherche du chercheur visent à cibler ce qui doit être corrigé dans les algorithmes afin de pallier les problèmes de sécurité et de confidentialité qui minent la confiance des gens à l’égard de l’IA. Les réserves du public en ce qui a trait à la technologie peuvent restreindre sa mise à contribution dans des domaines comme la médecine ou les services publics.
« À l’heure actuelle, nous ne savons pas vraiment à quel moment on peut avoir confiance en la véracité des prévisions générées par l’apprentissage automatique. C’est donc l’une des principales raisons qui motivent nos travaux de recherche, notamment pour se doter de mécanismes à sécurité intégrée fiables permettant de déterminer lorsqu’une prévision sera inexacte ou exacte. »
M. Papernot se dit « très touché » par l’obtention de la Bourse de recherche Sloan.
« Cette distinction me confirme que nous pouvons continuer de cibler des problèmes présentant un haut risque en matière de recherche, explique-t-il, car c’est ainsi que l’on réalise les plus grandes percées. Cette validation externe qui confirme que l’on s’intéresse aux bons problèmes est toujours la bienvenue lorsque l’on prend davantage de risques. »
-
 Örjan Sandred
Örjan SandredBourse de recherche Guggenheim
Musique
Örjan Sandred
Un compositeur suédois-canadien crée une nouvelle forme de musique grâce à l’intelligence artificielle
Bourse de recherche Guggenheim
MusiqueÖrjan Sandred, professeur de composition à la University of Manitoba, s’est vu décerner en 2022 une Bourse de recherche Guggenheim pour l’appuyer dans la réalisation d’un projet axé sur la musique électronique en direct contrôlée par l’intelligence artificielle. Le compositeur d’origine suédoise-canadienne collabore avec le quatuor à cordes Stenhammar à la création de la composition.
Une grande partie du travail de M. Sandred est axé sur la recherche de nouvelles méthodes de composition, y compris les techniques de composition à base de règles assistée par ordinateur, où celui-ci assiste la personne qui compose. Ses pièces musicales font appel à la musique électronique en direct et, à l’occasion, au traitement vidéo en direct, des techniques qui emploient des microphones et des caméras vidéo afin d’opérer un contraste entre les stimuli visuels et auditifs.
M. Sandred explique que l’intelligence artificielle l’a amené à approfondir la manière dont les paramètres musicaux comme la pulsation, le rythme, la tonalité et le timbre interagissent pour générer de puissantes expressions musicales. « La musique se forme ultimement dans le cerveau, voilà pourquoi il s’agit selon moi d’un excellent outil permettant de mieux comprendre le cerveau humain. Les structures musicales sont le reflet de son fonctionnement. »
Par l’entremise d’une commande du Conseil des arts du Manitoba à la pianiste Megumi Masaki, M. Sandred a pu mener à bien une étude préliminaire pour son projet lié à la Bourse de recherche Guggenheim, qui lui a permis d’examiner la façon dont un ordinateur peut apprendre le style d’une prestation de piano au moyen de cartes auto-organisatrices, pour ensuite formuler une réponse musicale basée sur ces apprentissages.
La musique de M. Sandred se retrouve sur les albums Sonic Trails (2020) ainsi que Cracks and Corrosion (2009), et la deuxième édition de son livre, The Musical Fundamentals of Computer Assisted Composition, est maintenant disponible.
-
 Peggy St. Jacques
Peggy St. JacquesBourse de recherche Sloan
Psychologie
Peggy St. Jacques
Percer le mystère des souvenirs du monde réel
Bourse de recherche Sloan
PsychologieComment les souvenirs d’expériences vécues sont-ils formés par le cerveau? Voilà une question à laquelle Peggy St. Jacques tentera de répondre grâce à la Bourse de recherche Sloan qu’elle a obtenue en 2022.
« J’étudie les souvenirs de faits vécus, la manière dont le cerveau forme ces souvenirs épisodiques », explique Mme St. Jacques, professeure de psychologie à la University of Alberta. « Nous en savons beaucoup sur la manière dont le cerveau emmagasine ces expériences, mais nous ne pouvons pas vraiment examiner ce qui s’y passe lorsque les gens sont en train de les vivre. Toutefois, grâce aux avancées technologiques, nous pouvons maintenant reproduire le monde réel en laboratoire. »
C’est ce que Mme St. Jacques tentera de réaliser grâce à sa Bourse de recherche Sloan. Son équipe produit des vidéos du monde réel en 360 degrés dans le but de créer des environnements immersifs en réalité virtuelle.
« Notre laboratoire est muni d’un casque qui présentera les vidéos en 3D afin d’offrir une expérience immersive. Les gens pourront ainsi vivre l’expérience à la première personne, comme s’ils étaient dans le monde réel, alors qu’ils seront en fait en observation grâce à un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM), explique-t-elle. Nous pourrons ainsi examiner l’activité neuronale dans le cerveau en temps réel et comprendre comment les souvenirs sont formés. »
Les troubles de la mémoire réelle caractérisent certaines maladies comme la maladie d’Alzheimer, dit-elle, « mais nous ne savons pas vraiment comment le cerveau emmagasine les expériences vécues. J’espère que les découvertes que nous ferons pourront aider à mieux comprendre ce type de troubles et de maladies. »
Mme St. Jacques se dit honorée de recevoir « une récompense aussi prestigieuse » que la Bourse de recherche Sloan. Le financement servira à embaucher du personnel de laboratoire et à couvrir les dépenses liées à l’IRM.
-
 Yanquin Wu
Yanquin WuBourse de recherche Guggenheim
Astronomie et astrophysique
Yanquin Wu
Une astronome explore l’origine des planètes
Bourse de recherche Guggenheim
Astronomie et astrophysiqueGrâce à l’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim en 2022, Yanqin Wu, professeure d’astrophysique théorique au Département d’astronomie et d’astrophysique David A. Dunlap de la University of Toronto, sera en mesure d’approfondir ses travaux de recherche sur la formation des planètes autour des étoiles.
« Les astronomes aiment comprendre comment tous les éléments de l’univers se forment. De mon côté, je m’intéresse particulièrement à la formation des planètes et à la compréhension de leurs origines », précise Mme Wu, dont les travaux de recherche portent sur les disques protoplanétaires, soit des nuages constitués de gaz et de poussières qui entourent les étoiles naissantes.
La professeure se concentre plus particulièrement sur les disques segmentés.
Au cours de sa carrière, Mme Wu s’est intéressée aux planètes à l’intérieur et à l’extérieur du système solaire. Elle utilise des données recueillies par le télescope spatial Kepler, chasseur d’exoplanètes, et par d’autres programmes d’observation pour examiner leur structure, leurs mouvements et leur formation.
« Nos théories sont fondées sur des données récoltées par les plus grands télescopes et observatoires du monde, indique-t-elle. Nous utilisons notamment beaucoup de données recueillies lors de missions spatiales. »
Mme Wu mentionne que les retombées de l’astronomie sont souvent ignorées ou incomprises. « Nous sommes avant tout des êtres humains qui s’intéressent au monde, nous avons une curiosité innée, affirme-t-elle. Et si nous n’allons pas au bout de cette curiosité, alors nous sommes une espèce plutôt ennuyeuse. »
-
 John Zilcosky
John ZilcoskyBourse de recherche Guggenheim
Langues et littérature germaniques
John Zilcosky
De Platon à Hulk Hogan : Un chercheur raconte l’histoire étonnante de la lutte
Bourse de recherche Guggenheim
Langues et littérature germaniquesLa lutte est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît, et le chercheur John Zilcosky de la University of Toronto rédige un ouvrage pour en faire connaître l’histoire fascinante. Les travaux qu’il entreprend dans le cadre de son projet intitulé Wrestling : A cultural history from Plato to Hulk Hogan (L’histoire culturelle de la lutte, de Platon à Hulk Hogan) lui ont valu l’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim en 2022.
Professeur de littérature allemande et comparative, M. Zilcosky soutient que la lutte, le plus vieux sport au monde, a été déterminante dans la naissance de la civilisation.
« L’un de mes arguments est que Platon a su reconnaître l’importance de la lutte pour bâtir une société rationnelle. Contrairement aux autres sports, la lutte témoigne de la violence entre les êtres humains. »
Son ouvrage portera sur les raisons pour lesquelles les gens luttent ainsi que sur les origines du sport. M. Zilcosky en retracera l’histoire depuis les premières civilisations jusqu’à l’avènement de la lutte professionnelle telle qu’on la connaît aujourd’hui, en passant par l’ère classique, la Renaissance et l’ère moderne, et explorera également la présence de la lutte dans les cultures autochtones et sa pratique chez les femmes.
« Dans ce premier ouvrage sur l’histoire de la lutte, je soutiens que son principal attribut est qu’elle parvient à exprimer et à mettre en scène à la fois la violence et le sexe : deux hommes s’étreignent de manière agressive sans pour autant se tuer ou se violer, explique-t-il. Nous regardons ces personnes qui tentent à la fois de se blesser et de ne pas se blesser, personnifiant l’ambivalence de ce qui fait de nous des êtres humains. »
M. Zilcosky a fait de la lutte compétitive durant sa jeunesse et a fait partie de l’équipe de lutte de l’Université Harvard pendant ses études de premier cycle. Son projet de recherche est pour lui « une passion » et espère que son nouvel ouvrage atteindra un auditoire diversifié et stimulera une nouvelle réflexion sur ce sport et la civilisation.
M. Zilcosky affirme que l’obtention d’une Bourse de recherche Guggenheim est d’une grande aide parce qu’il réalise une grande partie de son travail seul. « Le fait que mes travaux soient reconnus par une grande fondation comme la Fondation Guggenheim m’indique qu’ils sont importants et que les gens s’y intéressent. Cette bourse me permettra de prendre des risques que je n’aurais peut-être pas pris autrement et de voir grand. Grâce à l’appui d’une fondation comme celle-ci, j’oserai peut-être avancer des arguments sur la façon dont la lutte est liée au début de la civilisation et sur ce que signifie être un être humain. »
-
 Description des prix
Description des prixDescription des prix
Description des prix
Prix mondial des sciences Albert-Einstein
Le Prix mondial des sciences Albert-Einstein est décerné par le Conseil mondial de la culture afin de récompenser et de promouvoir la recherche et le développement scientifiques et technologiques. Une attention particulière est accordée aux chercheuses et chercheuses dont les travaux ont engendré de réelles retombées pour l’humanité et contribué à son bien-être.Prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA
Les prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA visent à souligner et à promouvoir les activités de recherche et de création artistique de calibre mondial, en récompensant les personnes dont les travaux se distinguent par leur originalité et leur apport théorique, contribuent à repousser les frontières du savoir et auront des retombées durables.Prix Breakthrough
Considérés comme les « Oscars de la science », les prix Breakthrough récompensent les plus grands esprits scientifiques du monde entier. Les prix, d’une valeur de trois millions de dollars américains chacun, sont décernés dans les disciplines des sciences de la vie, de la physique fondamentale et des mathématiques.Prix internationaux Canada Gairdner
Les Prix internationaux Canada Gairdner sont décernés à des scientifiques dont les travaux exceptionnels ont contribué à l’avancement des connaissances en biologie et maladies humaines ainsi qu’à l’atténuation de la souffrance humaine.Prix de la Fondation Einstein pour la promotion de la qualité en recherche
Les Prix de la Fondation Einstein pour la promotion de la qualité en recherche visent à souligner et à faire connaître les personnes dont les travaux remarquables contribuent à augmenter la rigueur, la fiabilité, la robustesse et la transparence en recherche. Ces récompenses cherchent également à multiplier les activités visant à favoriser la qualité en recherche et à y sensibiliser les scientifiques, les organismes, les investisseuses et investisseurs et les membres de la classe politique.Bourses de recherche Guggenheim
Chaque année, la Fondation commémorative John Simon Guggenheim décerne des bourses de recherche à environ 175 individus d’exception s’étant illustrés dans les domaines des sciences sociales, des sciences naturelles, des sciences humaines et des arts.Prix mondial de l’éducation José-Vasconcelos
Le Conseil mondial de la culture décerne le Prix mondial de l’éducation José-Vasconcelos à une ou un pédagogue de renom, une sommité de l’enseignement ou un individu ayant fait preuve d’innovation en matière de politique éducative.Prix Princesse des Asturies
Ces prix sont décernés annuellement en Espagne par la Fondation Princesse des Asturies (auparavant la Fondation Prince des Asturies) à des personnes, des groupes ou des organisations de partout dans le monde qui ont réalisé d’importants exploits dans les domaines des sciences, des sciences humaines et des affaires publiques.Bourses de recherche Sloan
Les Bourses de recherche Sloan, offertes sur deux ans, sont décernées chaque année à des scientifiques et à des universitaires en début de carrière dont les réalisations et le potentiel uniques les classent parmi les étoiles montantes et les chefs de file influents aptes à apporter des contributions majeures à leur domaine de recherche.Prix Wolf
Les prestigieux prix Wolf sont décernés à des scientifiques et à des artistes d’exception du monde entier pour récompenser des réalisations ayant servi les intérêts de l’humanité et favorisé les relations pacifiques entre les peuples, et ce, sans égard à leur nationalité, leurs origines ethniques, la couleur de leur peau, leur religion, leur genre ou leurs opinions politiques.


